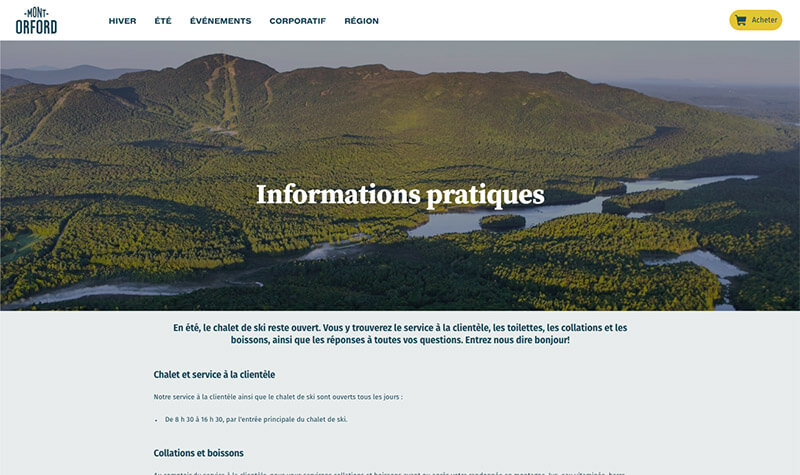Mettre le plein air de proximité sur la carte : les outils de l’accessibilité informationnelle
L’offre de plein air de proximité au Québec ne cesse de s’enrichir. Cependant, pour que celle-ci profite pleinement à la population, elle doit d’abord être connue, comprise et facilement repérable. En complément de l’accessibilité physique, un accès fluide à l’information permet d’amplifier les retombées et de rendre l’expérience encore plus complète. L’accessibilité informationnelle est un levier essentiel pour assurer le succès et la fréquentation des sites, tout en favorisant l’inclusion et la diversité des clientèles.
Qu’est-ce que l’accessibilité informationnelle?
L’accessibilité informationnelle est la mise à disposition de contenus, d’informations et de services qui sont utiles et utilisables par la clientèle. Cela peut, par exemple, être :
• D’offrir à la population des cartes interactives et des informations claires, fiables et à jour en amont d’une visite (sites Web, médias sociaux, applications, etc.).
• De faire connaître l’offre de plein air de proximité grâce à une stratégie de communication et de promotion, en utilisant différents types de supports communicationnels.
En intégrant une stratégie de communication et de promotion ciblée, concertée et efficace à la planification et à la gestion des activités et des espaces de plein air, les gestionnaires et partenaires ont la possibilité d’élargir leur audience, en plus d’accroître la notoriété des sites de pratique et des activités offertes. Il s’agit d’un excellent moyen de multiplier les retombées positives.
Cet article met en lumière des outils concrets et des initiatives inspirantes qui contribuent à rendre les activités et les lieux de plein air plus visibles, attrayants et accessibles à toutes et à tous. Il vise à faire de l’accessibilité informationnelle un réflexe incontournable dans la planification, le développement et la promotion du plein air de proximité.
Les outils cartographiques et numériques
Les premières stratégies de diffusion et de promotion du plein air de proximité souvent utilisées sont sans contredit les outils cartographiques et numériques. Des cartes interactives aux applications mobiles spécialisées, ces technologies ont profondément transformé notre façon de découvrir, de planifier et de pratiquer des activités de plein air. Elles sont aujourd’hui indispensables pour diffuser l’information auprès du grand public.
Des informations pratiques
Lorsqu’il s’agit de planifier une prochaine sortie, Internet et les applications numériques, développés par les gestionnaires de sites, offrent des informations complètes et à jour.
Parmi ces modalités, les cartes interactives occupent une place centrale permettant de localiser l’offre sur le territoire, en plus de fournir des informations pratiques, telles que les horaires, ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation du site (et souvent bien plus).
- Utilisées à l’échelle locale, elles permettent aux villes et aux municipalités de faire connaître leurs réseaux de parcs et d’espaces verts (ou blancs) ainsi que leurs sentiers. Elles serviront aussi à partager, entre autres, des renseignements en matière d’accessibilité physique. Par exemple, plusieurs sites Web municipaux proposent aujourd’hui des cartes interactives qui facilitent la découverte et la compréhension du territoire, à l’image de celles de Rouyn-Noranda, de Sorel-Tracy ou de la cartographie des ruelles vertes de Montréal.
- À l’échelle régionale, elles deviennent des vecteurs de mise en valeur de parcours et de circuits traversant plusieurs territoires municipaux. L’exemple du Sentier cyclable et pédestre Oka – Mont-Saint-Hilaire illustre bien ce rôle. Sur 143 kilomètres, il relie trois parcs nationaux ainsi que le Centre de la Nature Mont Saint-Hilaire : voir la carte interactive.
- À l’échelle nationale, elles répertorient et illustrent des initiatives de plein air à travers tout le Québec. Portées par des fédérations ou des organismes rassembleurs, elles adoptent souvent un angle thématique spécifique, faisant de ces outils des références en la matière. Ces cartes et partenariats qui les soutiennent deviennent particulièrement intéressants pour les plus petites municipalités et les organismes qui ne disposent pas toujours des technologies ou des ressources nécessaires pour développer et maintenir elles-mêmes de tels outils. Parmi les exemples marquants citons :
- Balise Québec par Rando Québec
- Carte interactive des sentiers de vélo de montagne et de fatbike, par Vélo Québec
- Carte interactive de la Route bleue, par Canot Kayak Québec
- On y va - Espace découverte, par Réseau plein air Québec
- Spéléologie et canyonisme, par SpéléoQc
L’accès à l’information peut également se faire via une plateforme numérique. Par exemple, plusieurs fédérations offrent désormais des applications mobiles qui facilitent l’accès à l’information et à la planification d’activités directement sur le terrain.
- Application mobile de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade (FQME) : elle permet de découvrir et de localiser les sites d’escalade et de montagne à travers le Québec, en plus d’offrir des outils pratiques pour les membres.
- Application Ski de fond Québec : elle propose une carte interactive des centres de ski de fond, elle permet de connaître les conditions de neige en temps réel et elle offre des suggestions de parcours pour les amateurs de glisse.
Découvertes et promotion
Les outils numériques, tels que les cartes interactives, les sites Web ou les applications, jouent également un rôle dans la promotion de l’offre de plein air. Ils permettent de présenter l’étendue de l’offre de services, qu’il s’agisse de proposer des circuits thématiques, de mettre en lumière des partenaires à proximité ou encore de suggérer des services complémentaires qui enrichissent l’expérience des pratiquants et des pratiquantes.
Si ces approches sont largement connues auprès des offices de tourisme, elles gagnent à être intégrées chez les gestionnaires de sites de plein air et des municipalités. Le Parc des Sommets de Bromont, par exemple, propose sur sa plateforme Web des suggestions d’itinéraires qui orientent les visiteurs, en plus de faciliter la découverte des plus beaux points de vue dans son réseau de sentiers. De son côté, le Mont-Orford mise sur des recommandations de partenaires locaux afin d’élargir et de diversifier l’expérience proposée.
Voici quelques exemples :
- Parc des Sommets - Sentiers Bromont - Location Billetterie Boutique | Randonnée
- 3 jours pour s'amuser en plein air | Visiter Québec
- Quoi faire tout près en été | Mont-Orford
Les outils médiatiques et de partenariat
Utiliser différents canaux
Un autre volet de l’accessibilité informationnelle est de varier les canaux de communication selon les publics visés. Le développement d’un plan de communication permet de tenir compte des besoins et des habitudes médiatiques des différents groupes ciblés, tout en adaptant le ton, les messages et les formats de diffusion.
Si les outils numériques sont aujourd’hui incontournables pour rejoindre le public, les modes de communication plus traditionnels conservent encore toute leur pertinence. Journaux locaux, bulletins municipaux, radio communautaire, campagnes dans les écoles, affichage au sein des organismes communautaires, dans une boutique de plein air ou directement sur les sites de pratique… Ces canaux permettent de rejoindre des publics différents et d’élargir considérablement la portée des messages.
Le succès d’une stratégie de communication repose également sur la force des partenariats. Collaborer avec les acteurs déjà présents dans le milieu, comme les associations sportives, les clubs de plein air, les commerces locaux, les offices de tourisme, les centres communautaires, les institutions scolaires ou les établissements de santé, permet d’amplifier la diffusion des messages et de créer un sentiment d’appropriation collective. Par exemple, une municipalité peut s’associer à une école pour promouvoir les sentiers locaux dans le cadre d’un projet éducatif, ou à une entreprise de plein air pour mettre en valeur les lieux de pratique sur ses canaux.
En combinant intelligemment les approches numériques et traditionnelles, il devient possible de rejoindre une plus grande audience et d’assurer la démocratisation de l’accès au plein air.
S’initier au plein air, c’est l’adopter!
Certaines personnes n’osent pas se lancer dans la pratique d’activités de plein air de proximité, souvent par méconnaissance ou manque de confiance. Ce peut être notamment le cas des nouveaux arrivants qui font face à un contexte naturel inconnu à apprivoiser. Afin de surmonter ce défi, des organismes offrent des séances d’initiation au plein air dédiées à ce public.
À titre d’exemple, Plein air interculturel de l’Estrie a pour mission de favoriser l’inclusion des personnes immigrantes par le plein air et la découverte de la nature, tout en favorisant le vivre-ensemble. De nombreuses activités de plein air sont organisées dans la région de Sherbrooke, certaines au cœur même de la ville. Celles-ci permettent à des milliers de nouveaux arrivants de découvrir chaque année le plein air de proximité.
Rassembler pour faire rayonner le plein air
Un bon outil pour faire connaitre les lieux de pratique de plein air de proximité est d’organiser des événements rassembleurs qui regrouperont la population et attireront de nouvelles clientèles. Il peut s’agir d’organiser des événements ludiques, comme des activités de découverte ou d’initiation à une activité, la tenue d’un festival, un concours photo ou des ateliers d’initiation aux équipements, etc. Ces activités permettent de mettre en valeur le potentiel d’attractivité des lieux.
L’organisation d’un festival de plus grande envergure peut également être l’occasion de découvrir des lieux de plein air et d’expérimenter de nouvelles pratiques. C’est le cas, par exemple, de ces trois festivals :
- Grimpe en Ville, à Rivière-du-Loup, propose de l’escalade de glace au cœur de la ville.
- Festival Expé, à Notre-Dame-de-Montauban, en Mauricie, propose notamment l’initiation à de nombreuses activités de plein air (kayak et planche à pagaie en eaux vives, course en sentier, etc.)
- Festival Norr, à la Vallée Bras-du-Nord, propose de nombreuses activités de plein air et d’initiation (SUP yoga, orientation en forêt, vélo de montagne, spéléologie, etc.)
Sensibiliser le public et prévoir une signalisation adéquate
Les informations sur les bonnes pratiques à observer pour une pratique éthique et responsable du plein air sont tout aussi importantes à diffuser, que ce soit en amont ou sur les lieux de pratique. C’est par exemple la mission du programme Sans trace Canada, un organisme sans but lucratif qui se consacre à la promotion de l’éthique du plein air afin d’encourager la population à jouir des bienfaits de la nature, tout en protégeant le patrimoine naturel et culturel au pays.
Sur place, à titre d’exemple, il importe de prévoir certaines communications des mesures prises pour répondre à un fort achalandage, afin de s’assurer que le lieu de pratique reste en bon état (stationnements supplémentaires, navettes, postes d’accueil, surveillance accrue, activité d’initiation et d’encadrement pour les débutants, etc.).
Aussi, il peut être salutaire de placer une affiche au début des sentiers et des sites de pratique afin de rappeler le code de bonne conduite à adopter (exemple : vitesse maximale, sens du déplacement, respect des pratiquants et de l’environnement), ou de rappeler les éléments essentiels à avoir avec soi pour l’activité (ex. : bouteille d’eau, collation, chasse-moustique).
Enfin, pour enrichir l’expérience du plein air de proximité, il peut être pertinent de lier nature et culture à travers des aménagements d’interprétation, qu’il s’agisse de panneaux sur la faune et la flore, de capsules sur l’histoire des lieux ou d’œuvres artistiques intégrées au paysage. Ces initiatives contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance et à valoriser la richesse culturelle et naturelle du territoire.
Informer la population des lieux et activités de plein air constitue un levier essentiel dans le développement et la valorisation du plein air de proximité. Grâce à une diversité d’outils numériques et traditionnels, les acteurs du milieu disposent aujourd’hui de moyens efficaces pour faire connaître l’offre, rejoindre de nouveaux adeptes et bonifier l’expérience des utilisateurs. Cela contribue également à la qualité de l’expérience de la clientèle desservie.
Mais au-delà de la simple diffusion d’informations pratiques, la communication joue aussi un rôle stratégique en mettant en valeur les bienfaits et les retombées positives de la pratique du plein air de proximité.
Ainsi, l’accessibilité informationnelle se révèle être un facteur clé du succès, en renforçant à la fois la visibilité, l’attractivité, l’impact social et les bénéfices sur la santé des espaces et des activités de plein air de proximité.